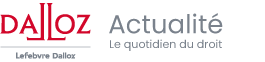- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Avocat
Article
Révocation d’un contrôle judiciaire : d’une distinction des rôles à l’effet dévolutif de l’appel
Révocation d’un contrôle judiciaire : d’une distinction des rôles à l’effet dévolutif de l’appel
L’obligation pour la chambre de l’instruction de se prononcer sur la révocation du contrôle judiciaire est une conséquence de l’effet dévolutif de l’appel et non une évocation, celle-ci ne pouvant se borner à renvoyer le dossier au magistrat instructeur après avoir constaté que le juge des libertés et de la détention (JLD) avait outrepassé ses pouvoirs.
par Warren Azoulayle 5 octobre 2017
Si l’on trouvait en 1808 le principe autonome selon lequel le juge d’instruction pouvait accorder sa « liberté provisoire » à l’individu encourant une peine correctionnelle moyennant caution solvable (C. instr. crim., art. 95 C), c’est par la loi tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens (L. no 70-643, 17 juil. 1970) que le législateur décidait d’intégrer le cautionnement pénal au sein du contrôle judiciaire (CJ), l’objectif étant de ne l’autoriser que dans le cadre de l’instruction préparatoire (Archives de politique criminelle, 2001/1. 53, note A. Bouquet). Il devenait alors ce que d’aucuns ont pu considérer comme « une alternative à la panacée que semble constituer la détention provisoire pour certains magistrats » (V., not., Rép. pén., vo Contrôle judiciaire, par P. Dourneau-Josette et C. Girault, no 1), et peut désormais être décidé soit par le juge d’instruction, soit par le juge des libertés et de la détention (C. pr. pén., art. 138) depuis la loi dite « Guigou » (L. no 2000-516, 15 juin 2000). Pour autant, ces deux derniers ne sont pas dotés des mêmes prérogatives lors de la phase d’instruction préparatoire, et le mis en examen dispose du droit de bénéficier d’un double regard sur le fait de savoir si son contrôle judiciaire doit être révoqué en raison de l’effet dévolutif de l’appel.
Au cours d’une information judiciaire, un individu était mis en examen et le juge d’instruction lui notifiait son placement sous CJ assorti d’une obligation de verser un cautionnement en cinq fois. En raison de sa défaillance, le magistrat informant saisissait le JLD d’une demande...
Sur le même thème
-
Limites du pouvoir d’opposition du juge à la communication d’une copie du dossier de l’instruction aux parties
-
Non-transmission d’une QPC visant l’ancien régime de perquisition chez un avocat
-
Précisions sur le régime du contentieux des saisies contestées dans le cadre d’une perquisition chez un avocat
-
Transport dans un lieu clos aux fins de constatations matérielles : voyage aux frontières des perquisitions
-
La mise en œuvre de la loi « Confiance dans l’institution judiciaire » à l’épreuve du Conseil d’État
-
Instruction : irrecevabilité de l’appel interjeté par l’avocat non régulièrement désigné
-
Fins de non-recevoir et concentration en cause d’appel
-
Vers une réglementation du financement de contentieux par les tiers dans l’Union européenne
-
Le Défenseur des droits dans le procès civil
-
La réitération d’une fin de non-recevoir en appel : une affaire de dispositif